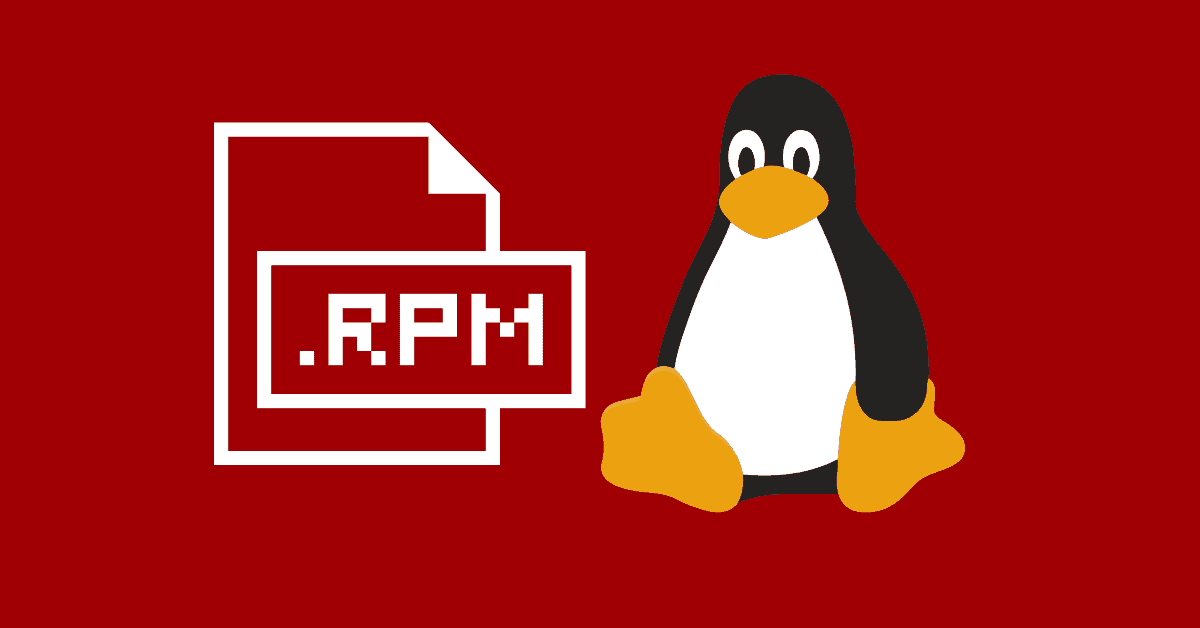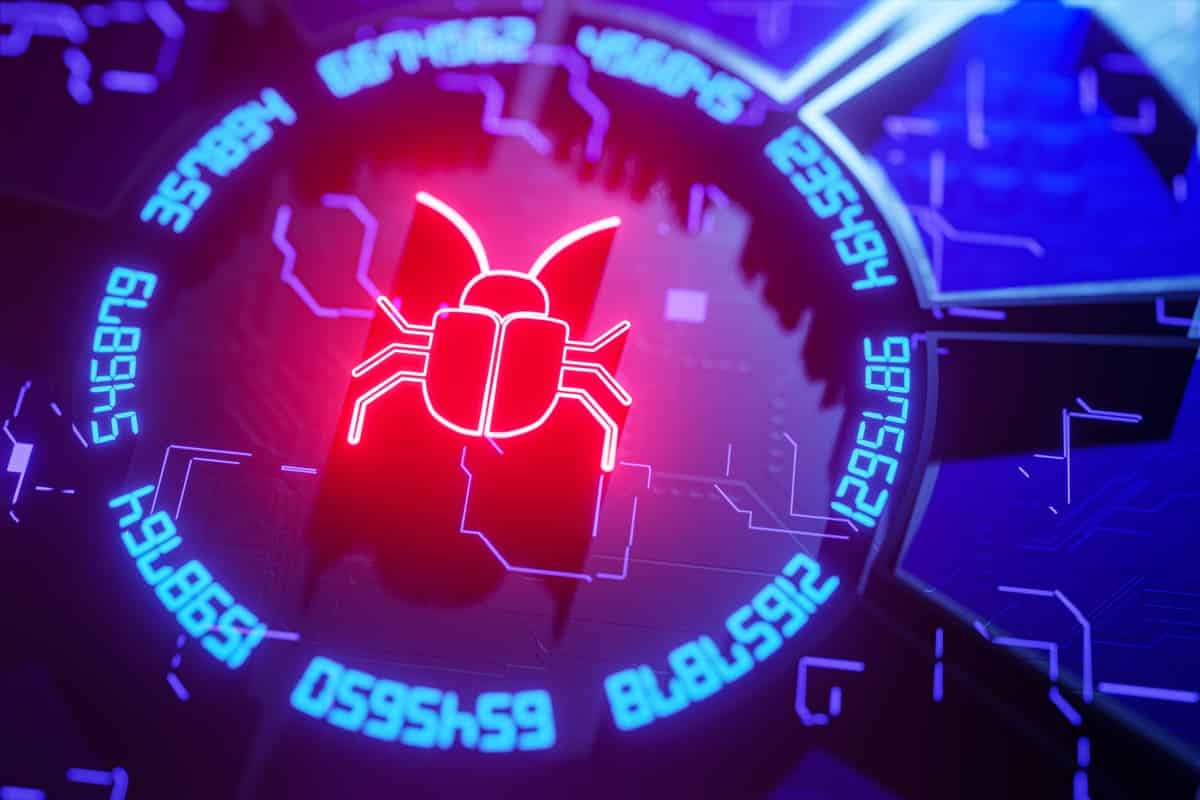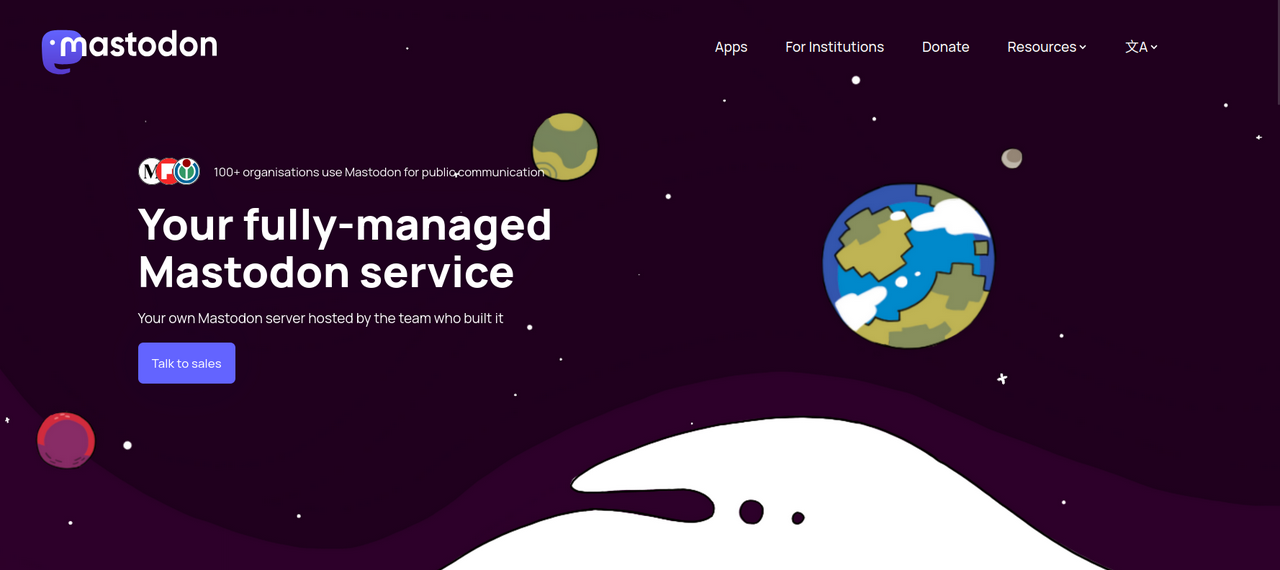Énergies fossiles – Le grand écart entre les promesses climatiques et la dure réalité

Le constat est sans appel. Les deux dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans l'histoire de l'humanité. Nous avons assisté, impuissants, à des saisons d'incendies dévastateurs au Canada, en Europe et en Amérique du Sud, tandis que des inondations et des vagues de chaleur meurtrières frappaient la planète entière.
Face à cette urgence climatique criante, on pourrait s'attendre à une mobilisation mondiale sans précédent pour abandonner les sources d'énergie qui nous mènent à la catastrophe. Pourtant, la réalité est tout autre et elle est profondément alarmante. Durant cette même période, les plus grands producteurs mondiaux de combustibles fossiles ont, au contraire, revu leurs plans de production à la hausse, nous engageant sur une trajectoire encore plus périlleuse.
Un rapport choc, publié aujourd’hui, vient jeter une lumière crue sur cette contradiction mortifère. Selon ses conclusions, les gouvernements prévoient de produire en 2030 plus du double de la quantité de charbon, de pétrole et de gaz compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris. Ce niveau de production planifié est même légèrement supérieur à celui de 2023, date de la dernière publication de ce document biennal, connu sous le nom de “Production Gap Report” (Rapport sur l'écart de production). Cette augmentation est principalement due à un ralentissement moins rapide que prévu de l'abandon du charbon et à des perspectives de production de gaz revues à la hausse par certains des plus grands acteurs mondiaux, notamment la Chine et les États-Unis.

Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, résume la situation avec une clarté glaçante dans la préface du rapport:
« Le “Production Gap Report” a longtemps servi de miroir tendu au monde, révélant le fossé béant entre les plans de production d'énergies fossiles et les objectifs climatiques internationaux. Les conclusions de cette année sont particulièrement alarmantes. Malgré les impacts climatiques records, la rentabilité évidente des énergies renouvelables et un fort désir d’action de la société, les gouvernements continuent d’étendre la production d’énergies fossiles au-delà de ce que le climat peut supporter. »
Évalué par des pairs et rédigé par des chercheurs du Stockholm Environment Institute, de Climate Analytics et de l'Institut international du développement durable, le document met l'accent sur le côté “offre” de l'équation climatique. Il dénonce les politiques gouvernementales (subventions, avantages fiscaux, octroi de permis) qui continuent d'encourager et de soutenir l'industrie des combustibles fossiles. Le message est simple et brutal: les gouvernements jouent un double jeu. D'un côté, ils affirment vouloir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. De l'autre, ils planifient la production continue des énergies mêmes qui causent cette pollution, à des niveaux qui rendent leurs propres objectifs climatiques totalement inatteignables.
Le rapport désigne les États-Unis comme « le cas le plus flagrant d'un pays se réengageant dans les énergies fossiles ». Les politiques mises en place, comme les milliards de dollars de nouvelles subventions aux compagnies pétrolières et gazières, l'expansion de l'accès au forage sur les terres publiques et l'accélération des permis pour les projets fossiles, vont à l'encontre de toute logique climatique.
Au total, les plans de 20 des plus grands pays producteurs ont été passés au crible, représentant plus de 80 % de la production mondiale. Les chiffres donnent le vertige: la production mondiale prévue de charbon, de pétrole et de gaz pour 2030 est supérieure de 120 % à ce qui serait compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 ∘C, et de 77 % supérieure aux scénarios visant à rester sous les 2 ∘C. Plus le réchauffement sera important, plus les conséquences en termes de phénomènes météorologiques extrêmes, de montée des eaux et d'autres impacts seront graves. À eux seuls, trois pays (la Chine, les États-Unis et la Russie) étaient responsables de plus de la moitié des émissions liées à l'extraction en 2022.
Quelques lueurs d'espoir subsistent. Le rapport souligne que six pays sur les vingt étudiés, dont le Brésil et la Colombie qui viennent de s'ajouter à la liste, élaborent désormais des plans visant à aligner leur production sur leurs objectifs climatiques. L'Allemagne accélère sa sortie du charbon, et la Chine déploie massivement les énergies éolienne et solaire. Ces mesures sont malgré tout nettement insuffisantes pour inverser la tendance mondiale.
Les auteurs appellent les gouvernements à cesser de penser en silos et à planifier collectivement une réduction de la production. L'enjeu est d'atteindre les objectifs climatiques sans provoquer de chocs économiques majeurs dans les régions dépendantes des revenus et des emplois liés aux industries extractives. C'est l'idée derrière les “partenariats pour une transition énergétique juste” (JETP), qui visent à financer la sortie du charbon dans les pays en développement. Malheureusement, ces programmes peinent à mobiliser des fonds suffisants.
En fin de compte, l'analyse révèle que de nombreux gouvernements continuent de planifier l'avenir comme si de rien n'était, en ligne droite. Ils prévoient une utilisation stable ou une baisse très progressive des énergies fossiles. Selon les experts, cette vision mène à une double impasse. Soit cette consommation reste élevée, conformément à ces plans, et nous plongeons dans un chaos climatique aux conséquences incalculables. Soit la transition s'opère de manière soudaine et non planifiée, car dictée par la réalité physique et économique, provoquant alors un chaos économique et social pour les pays non préparés.
Pour éviter ce double précipice, une seule voie est possible: aligner, dès maintenant et de manière radicale, nos plans de production d'énergie sur nos objectifs climatiques. Le miroir nous a été tendu. Il est encore temps de changer l'image qu'il nous renvoie.